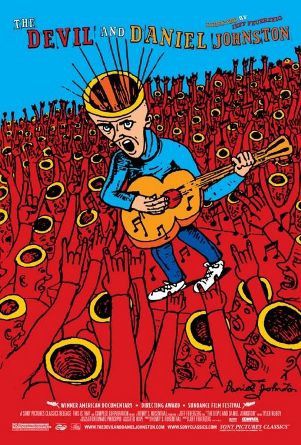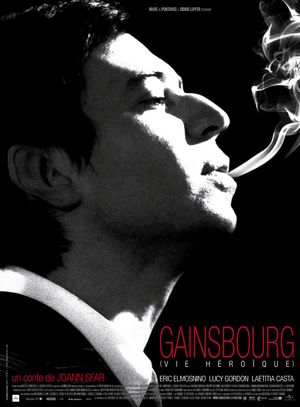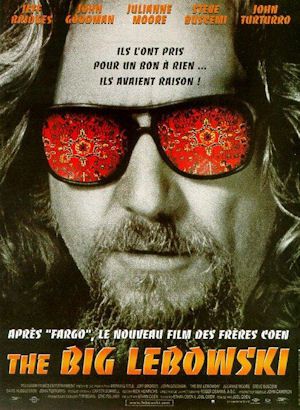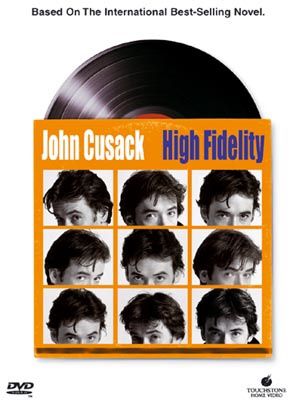Quadrophenia
Film de Franc Roddam (1979)
Ses parents ne comprennent pas Jimmy. Mais qu'est-ce qu'il a donc dans la tête, ce môme, pour rentrer à la maison à des heures indues après avoir traîné toute la nuit avec Dieu sait quels voyous? Toujours révolté, en colère, en train de râler contre tout et n'importe quoi. Une véritable boule de haine. Comme si monsieur avait des raisons de se plaindre: un toit, des parents qui l'attendent pour le rôti du soir, un boulot stable de coursier dans une agence de publicité. Et puis cette nouvelle façon de s'habiller, il paraît que c'est la mode. Avec ses cravates, ses parkas et ses costumes cintrés, on se demande vraiment pour qui il se prend. C'est bien simple, on ne le reconnaît plus. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour mériter un fils pareil? Quant à la musique qu'il écoute, si tant est qu'on puisse appeler ça de la musique, n'en parlons même pas. Une bande de braillards mal coiffés qui ne savent même pas jouer de leur instrument. Les Who, qu'ils s'appellent. Quand ils passent à la télé, Jimmy devient fou, enlève sa chemise, s'agite dans tous les sens. Effrayant.
Heureusement pour Jimmy, il y a le week-end et les potes. Des mecs qui le comprennent, des frangins qui vibrent pour les mêmes choses que lui, qui se fringuent comme lui. Une bande, quoi. Avec Dave, Spider, Chalky et Monkey, ses fidèles compagnons de virée, il écume les soirées londoniennes, se gave de speed et de rhythm and blues jusqu'au petit matin et se frite avec ces abrutis de rockers qui en sont restés à Gene Vincent. Et puis, il y a Steph. Elle est drôlement jolie, Steph, avec sa frange qui lui tombe sur les yeux, mais elle sort avec Pete, un vrai pauvre type. Une fois, ça a rendu Jimmy tellement malade de les voir danser ensemble qu'il a arrêté le slow en plein milieu pour faire cracher « My Generation » sur la platine. De temps en temps, il va la chercher à la sortie de son travail pour la ramener chez elle, en espérant vaguement qu'il se passera quelque chose. Peut-être à Brighton, en mai, lors du fameux week-end que tout le monde attend. Lui le premier.
Inspiré de l'opéra-rock éponyme des Who et sorti sur les écrans en 1979, Quadrophenia reste un des films majeurs sur les mods et la guerre de rue qui les opposa aux rockers, leurs meilleurs ennemis, au milieu des années soixante. Atteignant un pic de violence lors du « Whitsun weekend » de 1964, au cours duquel les deux camps transforment Brighton en champ de bataille, la confrontation horrifie l'Angleterre, persuadée d'abriter en son sein les légions du chaos. Sans réponse face à la colère volcanique de sa jeunesse, le pays, perplexe et incrédule, ne veut voir dans cette éruption que le signe avant-coureur d'une prochaine déchéance morale et l'annonce de son effondrement. L'incompréhension parentale envers Jimmy reflète l'attitude des institutions autoritaires et conservatrices envers ce combat fratricide dont les enjeux leur échappent. D'où sortent ces gamins? Au nom de quoi s'écharpent-ils? D'où tirent-ils cette rage, eux, les enfants d'une nation prospère, les rejetons des classes moyennes, les enfants chéris du baby boom? Autant d'énigmes qui rendent le phénomène d'autant plus inquiétant.
Les mods ne se déplacent qu'en scooter italien, passent des plombes devant le miroir à peaufiner leur look de petit minet friqué et ne jurent que par la musique noire américaine. Ils se définissent et se perçoivent comme les représentants de la coolitude absolue et s'identifient peu à peu à des groupes anglais qui font souffler un esprit nouveau sur la scène rock: les Who, les Kinks, les Small Faces. Pour eux, les rockers ne sont que de sombres ringards qui écoutent la musique de papa et ont trop regardé Brando dans L'équipée sauvage. Le blouson noir, les bottes, les chaînes, « Be bop a lula », le moteur de la bécane qui vrombit, tout ça c'est dépassé, has been, obsolète. Place aux riffs dévastateurs et à l'élégance rageuse. Le film ne ferme pas les yeux sur l'aspect absurde et vain de cette rivalité, notamment lorsque Jimmy et sa clique tabassent un rocker qui n'est autre que Kevin, son ami d'enfance.
Imparfait mais attachant (ou attachant parce qu'imparfait), Quadrophenia parvient à émouvoir parce qu'il se concentre sur un personnage entier, voire naïf, qui s'identifie tellement à la mouvance mod qu'il en vient à la considérer comme la seule chose vraie et précieuse dans son existence. Exalté et pur, il se jette à corps perdu dans l'aventure, n'existant que dans un présent qu'il vit avec une extrême intensité. I hope I die before I get old. Plus rien d'autre n'a d'importance: ni le regard des parents, ni la répression policière, ni les remontrances du patron. Seule compte l'interminable attente du vendredi et des folies nocturnes. Le désenchantement attend fatalement cet idéaliste au bout du chemin. Sa petite Steph le laisse tomber, ses copains rentrent dans le rang, le monde n'a pas changé et ne changera jamais. Il est le seul à y avoir vraiment cru, à avoir pris la chose au sérieux. Il a toujours été le seul. Restent le sentiment amer de s'être fait avoir, l'alcool et la solitude. Jimmy va trop vite, Jimmy pleurniche, il sent son parfum sur la corniche...Et si Souchon était un mod?
La bande-annonce du film: