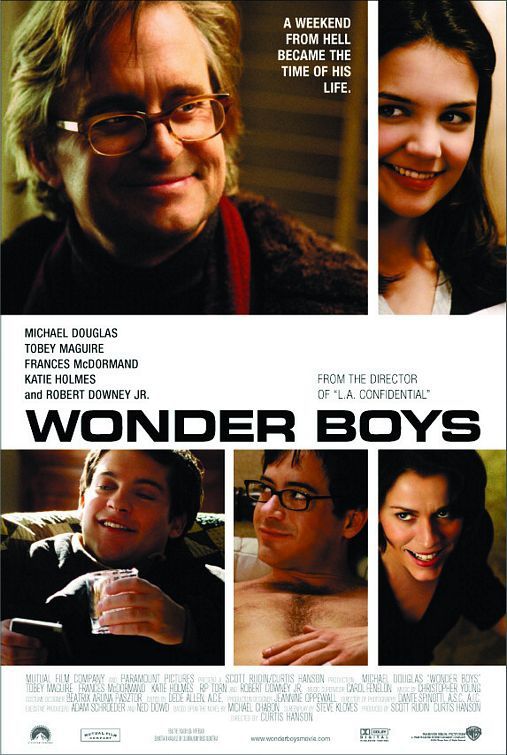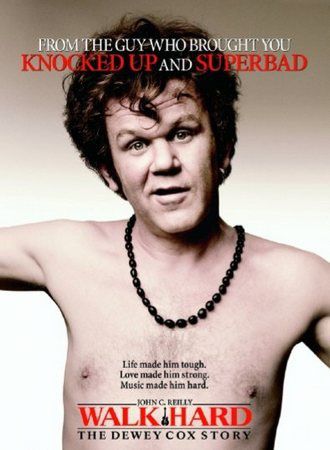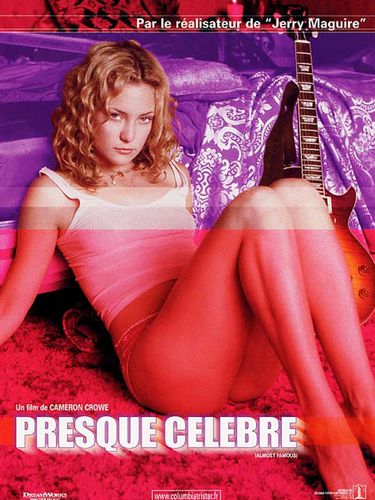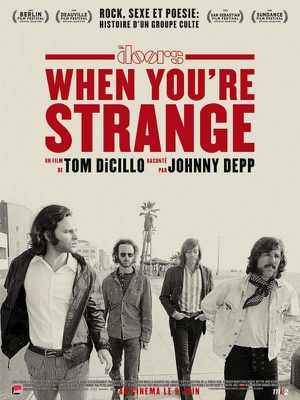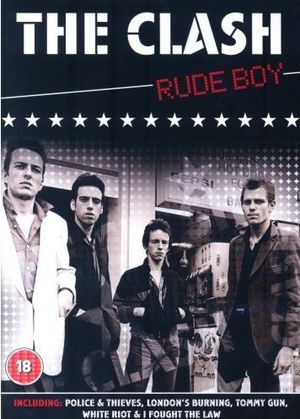George Harrison -
Living in the Material World
Film de Martin Scorsese ; 2011
George Harrison fut le deuxième Beatle à quitter ce monde matériel, il y a déjà un peu plus de dix ans. Des années après sa mort (il serait inapproprié de parler de disparition), certaines communautés religieuses de son Liverpool natal organisaient encore des services à sa mémoire. Sans vouloir donner dans l'hagiographie, il se dégageait de sa personne et de sa musique une grande sensibilité, une sincérité et une générosité sans fard, une fragilité plus prégnante que chez les autres membres du groupe. Toujours plutôt en retrait et effacé, il fut quelque peu écrasé par le tandem Lennon-McCartney, sans jamais chercher à imposer quoi que ce soit ou à attirer l'attention des médias. Harrison était un homme discret mais éminemment profond et conscient des souffrances du monde. Quand Ravi Shankar l'alerte sur l'ampleur de la catastrophe humanitaire qui frappe le Bangladesh, il met sur pied dans l'urgence un concert au Madison Square Garden dont la recette est reversée aux populations affamées, invite Eric Clapton, Leon Russell, Billy Preston, Ringo Starr et sort Dylan de sa retraite. Lennon aurait peut-être convoqué la presse pour un bed-in de protestation. Harrison, lui, a préféré laisser la vedette à Ravi Shankar, à qui revient l'honneur de jouer en premier.
Tous les témoignages réunis dans le documentaire (McCartney et Ringo Starr évidemment, mais aussi Eric Clapton, Terry Gilliam, Eric Idle, George Martin, Phil Spector ou Tom Petty) mettent en avant cette attention aux autres, cette qualité d'écoute et de compréhension. Bien sûr, comme le chantait Brassens, « les morts sont tous des braves types », mais il s'avère difficile de rester sceptique quand il s'agit d'Harrison. Au coeur du portrait géant signé Martin Scorsese se trouve également la quête mystique du guitariste du Fab Four, son attirance pour la spiritualité orientale, son intérêt pour la musique indienne, le mantra, la méditation transcendantale. Quoi qu'on puisse en penser, Harrison prenait la chose très au sérieux et sa démarche, nourrie par la curiosité et la soif d'apprendre, fut toujours empreinte d'une indéniable authenticité. Tout au long du film, on découvre une personnalité véritablement hors du commun, le parcours atypique d'une anti-star qui, après avoir racheté la vieille demeure de Friar Park et son immense parc en 1970, en vint à se définir lui-même davantage comme un jardinier que comme un musicien.
Scorsese a semble-t-il voulu signer un film-somme, une sorte d'hommage à la fois exhaustif et définitif, et n'a laissé de côté aucune des facettes de l'existence d'Harrison: sa place au sein des Beatles, sa carrière solo, sa vie privée et sentimentale, ses expériences avec la drogue, ses voyages et rencontres, ses amitiés, la tentative d'assassinat dont il fut victime deux ans avant sa mort, son rôle de producteur pour La vie de Brian des Monty Python ou encore la création des Traveling Wilburys à la fin des années 80. A vouloir trop en dire (le film dans sa version complète dure plus de trois heures) et explorer chaque détail, le réalisateur oublie de choisir un angle d'approche et d'apporter un regard nouveau sur Harrison, comme il l'avait si brillamment fait pour Dylan dans l'excellent No Direction Home. Au bout du compte, Living In The Material World se résume à une longue série d'interviews et d'images d'archives sans grand travail de montage ou de commentaire, un énorme assemblage d'anecdotes et de scènes de vie qui peut lasser le spectateur le plus intéressé par ses redites, ses retours en arrière, son manque global de structure et de clarté. Il faut vraiment être un inconditionnel d'Harrison pour tenir le coup jusqu'au bout.
Logiquement, ce sont les passages qui évoquent le musicien Harrison qui s'avèrent les plus riches et les plus réussis. Ne perdons pas de vue, braves gens, que Georgie était un songwriter de premier plan et a tout de même pondu pour les Beatles des morceaux magnifiques comme « Something », « While my guitar gently weeps » ou « Here comes the sun ». A force de voir ses compositions recalées par Lennon et McCartney (« Something » est le seul titre signé Harrison à être apparu en face A d'un single du groupe), il a accumulé des tonnes de chansons, parmi lesquelles il a puisé pour son premier album solo, le superbe All Things Must Pass. Les moments du film consacrés à la genèse et l'enregistrement du disque montrent un Harrison perfectionniste à l'extrême, capable de passer des journées entières sur le solo de « My Sweet Lord », toujours à la recherche du son et du réglage parfaits. Il est simplement dommage que le flot ininterrompu d'informations déversé par le film fasse presque passer au second plan le fait que le monsieur fut avant toute chose un guitariste de génie et un artiste majeur.
Bande-annonce :


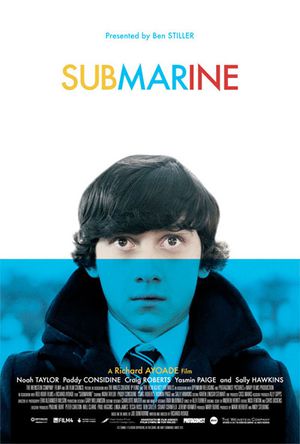 Submarine
Submarine Radiohead
Radiohead